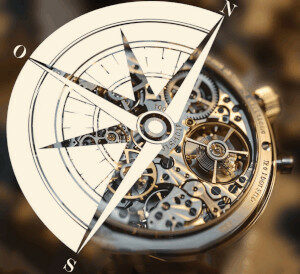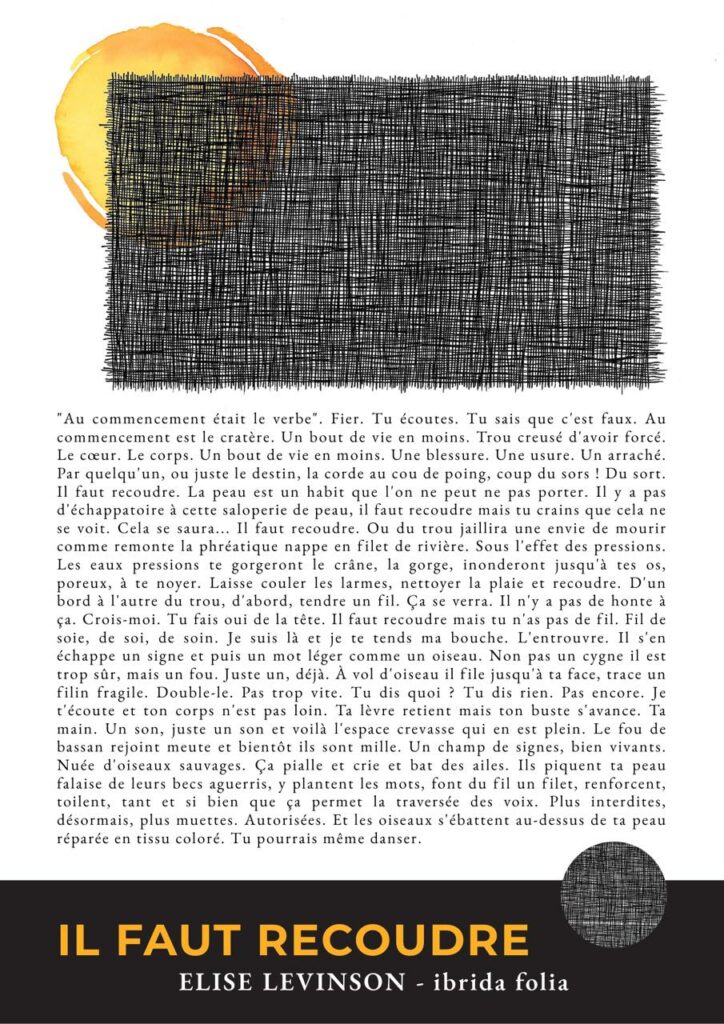
Coudre, recoudre, découdre
Structurée, déstructurée,
Folle de mode, folle du monde
Savoir, détenir, avoir
Laisse tout cela sur le chemin !
Lève la tête et regarde au loin !
Les coutures lustrées par le temps lâchent
Les tissages serrés s’effacent
Le visage lumineux,
Les épaules droites
les regards au loin
je vois pour la première fois
Premiers pas comme ceux d’un enfant
Hésitants et pleins de doutes
Mais cette fois je sais
en tournant la tête
Je ne suis pas seule
Un compagnon est là.
Imaginons, l’espace d’un instant, la rencontre de deux inconscients
Les voici, dans l’écoute du silence, tramant le sens de leur propre présence.
Files de mots en fils de maux, tressées par des cœurs d’hommes mus d’eau
Associant du soin au soi l’asociale, indicible et changeante intimité du vrai
Un temps suspendue, singulière, dans l’écho d’une oreille devenue familière.
Tisseront-ils ensemble une mise au monde ou une mise à mort ?
Réunion des contraires vers l’ouvrage improbable
Et pour autant irremplaçable qu’est l’être en devenir
C’est de cette rencontre que le vide se fait plein et que le trou s’enserre
Ouvrant tant de possibles sous l’auspice du lien
Universellement, l’individu s’éveille à lui-même dans l’autre
Dépassant les limites de sa longue solitude
Reflétée dans l’étant d’une psyché vivante
Enfin réconciliée au “je(u)”.
Il faut recoudre, d’Élise Levinson. Présenté comme étant un poème il m’est plutôt apparu comme une fable. La naissance.
Celle qui perce, transperce et qu’il faut recoudre. La mer placentaire, la mère vidée. Pleine puis peine du vide.
La fable de la première séparation, celle qui déchire les poumons, les chairs et les âmes. Alors il faut recoudre pour se réunifier, se reconstruire, se rapprocher. Mais il faut aussi recoudre pour relier, celui du dehors à celle du dedans puis à tous les autres. Chacun vient poser son point d’attache, que ça soit par la bouche tendue ou le bras enveloppant, le mot d’amour ou de rejet. Autant de liens qui façonnent cette peau dont on ne peut se défaire sans que ça soit mortifère.
Alors le trou est caché mais n’est-il pour autant plus ? La plaie cicatrisée mais visible. Petit trou ou petit bout de peau qui dépasse au mileu corps. Preuve irréfutable qu’à un moment nous étions liés à la vie à la mort.
Une reprise.
Pour le profane, le fil passe rarement du premier coup à travers le chas, il étend un filament mal aligné qui vient buter sur le rebord de l’aiguille, il se plie et résiste au mouvement qui insiste, il ondule, se déporte et glisse sur l’acier sans jamais atteindre la cible. Au départ, ça semblait simple, tellement évident qu’une seule ligne d’instruction suffirait. Mais, les essais se succèdent, les échecs s’accumulent, et chaque fois tout paraît de plus en plus compliqué, le doute et l’impatience troublent la vue, la frustration puis la colère coupent la respiration. La tâche impossible, rejetée sur un coin de table, attendra plus tard.
Le temps passe, justement. Le fil et l’aiguille, recouverts du blouson qu’il fallait réparer, ramassés avec lui dans l’urgence d’un jour de rangement, disparus au fond d’un placard. Qui s’en souvient ? Une vague image, une possibilité qu’un jour ce soit arrivé ? Et pourtant, je n’ai pas oublié. À chaque fois que le temps vire à l’orage, qu’il faut prendre la route par un jour un peu plus froid, un soir un peu plus noir, je cherche encore dans le placard ce vieux blouson que j’aperçois roulé au fond, repoussé. J’en aurais encore besoin, il irait mieux que cette parka neuve qui le remplace, plus confortable, tant porté qu’il tombe sans aucun poids sur les épaules, comme une peau sur la peau, une armure invincible, magique et familière. Et j’y repense, à la raison de sa mise à l’écart : la manche gauche déchirée, déchiquetée, en lambeaux du poignet jusqu’à l’épaule. Le tissu qui n’a pas résisté à l’abrasion, réduit en charpie, l’ouverture béante à hauteur d’avant-bras qui pourrait encadrer au centimètre près la cicatrice sur ma peau. Même si je ne sens plus rien, je me souviens, et l’intensité de la douleur demeure alors comme l’aveuglement qui suit l’éclair.
C’était une pluie d’été sur une route de banlieue, des traces d’essence et d’huile qui s’étalaient et s’irisaient le long des bordures. Le trafic déjà dense se gonflait d’une quantité d’affluents, les taxis en file serrée comme un serpent sans fin avant de passer sous la Tamise par le tunnel. Lorsque le feu passe au vert, je suis en première ligne, je pense déjà à la suite, la jonction vers la côte pour prendre le bateau et traverser jusqu’en France, la longue route du Nord jusqu’aux Alpes, avant la descente vers une autre mer ce soir, bien plus tard. Mon esprit s’évade et court déjà à des centaines de kilomètres d’ici, s’installe beaucoup trop loin. Ça va très vite, ce petit instant d’inattention. C’est presque instantané, la moto dérape à l’avant et tape violemment sur l’asphalte, glisse sur le flanc jusqu’à heurter le trottoir. Moi aussi, j’ai tapé, puis j’ai glissé. En me relevant rapidement pour la relever, pour évacuer la chaussée, je n’ai rien senti. Pour être plus précis, je ne sentais plus rien, je luttais en pilote automatique contre le brouillard cotonneux qui suivait la décharge d’adrénaline. Ce n’est qu’après avoir examiné les dégâts mécaniques, après avoir organisé la prise en charge par téléphone, que j’ai senti une gêne sur mon bras gauche, quelque chose qui n’était pas comme d’habitude. En attendant le dépannage, je suis resté presque une heure sans bouger et la douleur s’est tranquillement installée, diffuse, sourde, par vagues de plus en plus insistantes. À un moment, la fréquence est devenue prévisible, sans surprise. En regardant la manche de mon blouson, je me suis dit que ça pourrait se réparer.
Des années plus tard, ce sont parfois les évènements qui poussent dans un sens ou dans l’autre, des situations dans lesquelles on s’empêtre, des circonstances insolubles qui nous forcent à reconsidérer ce qui semble définitif. Voilà qu’arrive cette journée où je n’ai pas d’autre option : le vieux blouson devient nécessaire, j’en ai besoin pour un trajet urgent, imprévu. Quatre bandes de ruban adhésif font office de réparation, deux pour la doublure intérieure, deux à l’extérieur. Je n’ai pas le temps de recoudre le tissu proprement, je prends la route aussi vite que possible. Sur l’autoroute, le vent claque sur ma manche, écrase l’adhésif contre mon bras, s’écoule autour de cette nouvelle membrane plus fine que le reste du vêtement, et la peau en contact redevient sensible. Je me rassure, je me dis que, probablement, on ne tombe pas deux fois au même endroit. Et le souvenir de l’accident s’envole avec le vent, comme un ciel de traîne après l’orage.
Ma minuscule arme de métal passe à travers le textile sans résistance. Mes proches m’ont dit qu’elle n’en valait pas la peine, mais j’y tiens. Peut-être puis-je ajouter quelques broderies pour rattraper le coup ?
Mon aiguille manque de faire un nœud avec le fil de lin. Claquant la langue, j’ajuste mes coudes sur le bureau pour exposer le linge à un rayon doré, qui s’insinue timidement à travers la seule fenêtre de la chambre. La robe est ruinée… Non seulement ma chute l’a déchirée et mon ami l’a empirée en renversant son vin dessus… Et je suis la seule idiote à des kilomètres à la ronde qui passe une matinée ensoleillée à tenter — vainement, cela va de soi — de la sauver.
Ce vêtement est un souvenir que j’ai acheté par mes propres moyens, une des premières choses que je me suis offerte de moi à moi-même. Je voulais profiter de mon espoir de le secourir pour me découvrir un talent caché pour la couture… Mais ce fut un énorme « non » du destin. Force est de constater au bout d’une demi-heure que j’ai empiré la chose.
J’abandonne…
Un jet l’envoie droit dans ma poubelle. Le bruit sec sonne le glas de mon échec couturier.
— De toute façon, je dois y aller…
De toute manière, aurais-je osé le remettre une fois que je l’aurai retapé ?
Non…
Finalement, mes proches avaient raison ; cela n’en valait pas la peine.
À la fin de la journée, je me sens stupide. J’ai osé parler de ma vaine tentative à mes collègues. Mauvaise idée. Quand ils ont appris que j’avais gaspillé ma matinée à cela, j’ai pu analyser les différentes formes d’hypocrisies de l’humanité.
Entre ceux qui m’expliquent qu’ils rattrapaient n’importe quoi en un rien de temps car ils sont experts, ceux qu’il veulent me donner des conseils en couture pour étaler leur savoir car c’est un de leurs « passe-temps », ceux qui veulent me donner des conseils sans rien y connaître, ceux qui trouvait cela stupide car ils avaient l’argent de racheter la même robe deux fois, ceux qui n’en avait rien à faire et enfin ceux qui t’observent avec des grands en demandant ; « ah bon, tu as essayé ça ? » comme si c’était l’avènement de l’année, je ne me suis trouvée que trois options de réponses : les regarder silencieusement, faire semblant en hochant la tête ou afficher un air blasé.
Le soir en rentrant chez moi, je fixe ma poubelle avec un regard noir.
Et puis merde !
J’extirpe ma robe de là et prends ma caisse à couture. Des feuilles et un crayon, je dessine, les plans.
Retirer les manches pour enlever les taches de vin.
Enlever le col rond, faire un bustier.
Mettre des broderies à la ceinture pour couvrir le trou.
Une fois décidée, je me redresse. À la lampe de chevet qui perce le noir, je suis satisfaite.
— Eh bien, voilà.
Quand on me demanda d’où elle venait, je répondis :
— Je ne sais pas.
La Trame des Jours
Sous le regard brillant de la fine aiguille,
Le tissu s’abandonne et doucement se plie.
On trace à la craie, d’un geste décidé,
Les contours d’un rêve qu’il faudra façonner.
Le mètre-ruban enlace les épaules,
Mesurant le temps qui joue bien des rôles.
Puis les ciseaux entrent, d’un cri sec et franc,
Séparer le possible du simple néant.
Vient l’heure du bâti, ce lien provisoire,
Où l’on esquisse enfin le début d’une histoire.
Les épingles de verre, en sentinelles d’acier,
Retiennent les doutes sur le patron de papier.
La machine s’éveille, son rythme est un battement,
La canette dévide son cœur patiemment.
Une piqûre droite, un point d’arrêt solide,
Pour que jamais la vie ne devienne trop vide.
On ouvre les coutures au fer bien brûlant,
On dompte le biais, ce courant changeant.
Les surfils s’emmêlent comme des souvenirs,
Empêchant le passé de trop vite s’ouvrir.
Et quand vient la finition, le dernier ourlet,
L’ouvrage se révèle, parfait ou imparfait.
Car au bout de la soie ou du rude coton,
C’est soi-même qu’on coud, avec application.