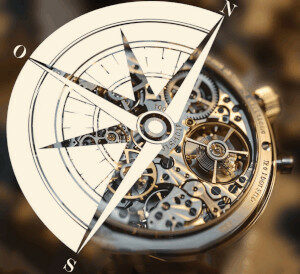L’attention, valeur ou marchandise ?
Dans une interview donnée en mai 2004 pour le livre Les dirigeants face au changement, Patrick Le Lay, alors PDG de TF1, confiait, non sans un certain cynisme, que le métier de son entreprise était de vendre « à Coca-Cola […] du temps de cerveau humain disponible ». Cette phrase qui lui valut de vives critiques n’en décrivait pas moins avec une lucidité désarmante la réalité de ce pour quoi nous nous trouvons bien souvent en lutte dans l’espace social autant que dans l’intime de la relation à soi : l’attention.
Au fil du désir
Qu’il s’agisse, comme semblent le promettre les pratiques de la pleine conscience, de revenir à soi ou, dans le registre de la communication interpersonnelle, d’obtenir l’écoute et la considération d’un autre, l’attention est le fil dont est tissé la continuité de notre rapport au monde. Qu’elle nous fasse défaut, de notre fait ou de celui de l’autre, et notre « monde » sera décousu, désordonné, déplacé. Qu’elle soit bien posée et nous rejoignons l’expérience d’une certaine fluidité.
À quelle adresse ?
Dans la tradition homérique, c’est à l’homme qu’il revient d’assurer son intégration dans un ordre du cosmos préalablement établi par les dieux. Quand il s’y refuse, à la faveur du symptôme, par exemple, sa « maison » s’affecte de désordre. Ses défenses auront beau jeu de distribuer les reproches, de voir dans ce désordre la conséquence d’un débordement de l’autre qui fait fuiter son attention, de nier sa propre responsabilité à s’être laissé déborder, disperser, détourner de son désir c’est à lui que revient au final la responsabilité de ce qu’il en fait.
« Notre attachement à voir l’attention prisonnière et à dénoncer les mécanismes de cet emprisonnement ne nous fait-il par perdre de vue l’essentiel, à savoir notre capacité à porter attention de plus près à notre attention elle-même, à la manière dont nous pouvons nous intéresser aux choses qui nous intéressent ou dont au contraire nous en sommes détournés ? » écrivais-je dans un article sur le même thème paru en pleine crise du Covid (2021) dans l’ouvrage collectif Ecosystémix (1). J’y traitais alors de l’attention que nous portions et de l’importance de cultiver une « aptitude à nous concentrer malgré [nos] distractions sur un objet initialement choisi ». Je voudrais à présent en explorer l’autre versant : celui de l’attention qui selon nous nous est portée ou du moins que nous estimons juste ou désirable d’obtenir.
Vacance et responsabilité
Dans son film de 1994 Coups de feu sur Broadway, Woody Allen se met lui-même en scène comme écrivain raté dont le talent réel n’aurait d’égal que l’ignorance tenace qu’il reçoit de ses pairs et de la critique littéraire. Cette attention qu’il n’obtient pas d’eux prend une valeur identitaire à la faveur d’un curieux renversement de sens. De fait, l’attention que nous recevons des objets qui comptent pour nous n’est pas toujours le reflet des qualités – d’attention – que nous leur avons témoigné. Tel est le drame courant de la scène amoureuse, de la difficulté à trouver sa place dans la frérocité compétitive des fratries, de la reconnaissance impossible dans le monde social, par la nature même des institutions que nous y investissons. Le Fernando Pessoa derrière le pseudonyme de Bernardo Soarès, malgré son immense talent, sera resté toute sa vie banquier. La prolifique liste d’hétéronymes que Pessoa s’attribua au fil de son existence d’auteur témoigne bien d’une difficulté parfois pleinement assumée de s’intégrer dans un fil de continuité quand l’attention de l’autre nous fait défaut, quand ce que je veux vivre, je ne le vis pas (2).
Les catégories de régimes attentionnels proposées par le sociologue Dominique Boullier (3) illustrent bien sur ce champ la manière dont nous pouvons alors tenter d’obtenir l’attention de l’autre en usant consciemment ou non des mêmes procédés que ceux par laquelle notre attention a été obtenue :
Qui des courriers d’alerte infertiles de cette patiente parentisée par ses proches pour préserver sa place protégée de cadette alors qu’elle se trouve propulsée au rang d’ainée de substitution suite au décès de sa sœur ?
Qui de cet autre patient, en tension avec sa compagne, poussant jusqu’à l’épuisement ses efforts pour la fidéliser dans l’attachement malgré l’empiètement permanent de sa belle-famille ?
Qui, encore, du débord agité de cet homme multipliant jusqu’à l’humiliation servile les projections à deux pour retenir à ses côtés une amitié qui lui est chère ?
Qui, enfin, de cette femme, reproduisant l’immersion de sa vie et celle de ses proches dans une suite ininterrompue de drames passionnels par lesquels elle cherche à se maintenir au centre d’une attention tout en ne parvenant qu’à s’y trouver satellisée ?
Telles sont autant de tentatives qui viennent se déposer sur le divan face à l’impossible obtention d’une attention de l’autre. Cette longue liste pourrait être déclinée en autant d’exemples singuliers. Elle dit bien l’aveu d’échec si universellement partagé de nos vies à être reçues à l’endroit de notre désir. Mais ce qu’elle ne dit pas, ce sont les deux questions que nous refusons de nous y poser.
La question de l’adresse, tout d’abord, de ce « qui » dont nous espérons l’attention, qu’il s’agisse d’un père, d’un amant, d’un lectorat, d’une institution pourtant bien incapable par sa nature de porter attention à qui que ce soit. Qui est cet autre, cet objet externe que nous avons investi d’un pouvoir de satisfaction de notre désir supposé ? Quelle est la réalité de la place singulière de cet objet au point qu’elle nous fasse ignorer toute l’attention que nous donnent déjà par ailleurs tant d’autres présences que nous avons rangées dans notre ordinaire ? Quand François Jullien nous parle de l’intime, quand Boris Cyrulnik contraste lien d’attachement et amour, ils ne font rien d’autre que de nous renvoyer à la différence entre ce qui brûle – auquel nous portons notre attention de papillon – et ce qui dure que trop souvent, nous ignorons à l’avantage du premier. Parce que notre attention suit le chemin du manque, et non celui du familier, de l’apparemment captif, du quotidien.
Vouloir quoi ?
Pour Adam Phillips (4), reprenant une réflexion de Freud sur l’opposition entre instinct et civilisation, la psychanalyse est une deuxième chance que les gens se donnent pour savoir ce « qu’ils peuvent faire » avec le constat que « nous voulons bien plus que ce que nous pouvons avoir [dans la culture] ». N’est-ce pas tant de cet autre alors dont nous attendons l’attention que de cette part d’instinct en nous-mêmes qui ne se sent vivante que dans le désir de ce que nous n’avons pas ? Et de ce que, bien souvent, nous n’obtiendrons pas. Comme le disait avec désinvolture le dramaturge Georges Bernard Shaw « il y a deux tragédies dans la vie. L’une est de ne pas obtenir ce que l’on désire ardemment. L’autre est de l’obtenir. »
Mais ce même auteur nous invitait aussi à faire « en sorte d’obtenir ce que [nous aimons] », sous peine de rester « forcés d’aimer ce que [nous obtenons] ». C’est là que la vente de « temps de cerveau humain disponible » dont TF1, parmi tant d’autres, a fait son affaire vient rejoindre la seconde question à laquelle nous tentons d’échapper : celle de notre responsabilité. Celle d’avoir fait vacance de notre désir en nous laissant croire qu’il était fondamentalement de même nature que le désir du striatum manipulé par les publicitaires. Adam Phillips parle de « vacances de l’attention » (vacancies) au double sens de vide et disponibilité. Selon lui « nous sommes plus grégaires, plus sociables, plus susceptibles d’être en lien les uns avec les autres que nous n’en sommes conscients ou que nous voulons le reconnaître » (5). Cette vacance est ce qui nous fait désirer non pas ce que nous désirons vraiment – ce qui finalement se profile dans le manque -, mais ce que d’autres désirent, ce qui a été rendu désirable par le social. Nous désirons par exemple dans le sens de l’anima ou de l’animus jungiens selon des projections archétypales qui nous précèdent, et disent juste l’histoire humaine de la rencontre avec les figures d’un autre désirable. C’est peut-être cela l’ordre prédisposé par les dieux auquel il nous reste à nous intégrer. Que faire alors quand cet autre archétypal est teinté de négativité, de l’autoritarisme écrasant d’un père tenu comme bon par nature malgré sa réalité violente, de l’intensité critique d’une mère jugeante dont l’amour maternel indéfusionnable n’est que façade à l’empiètement ?
C’est là, sans doute, le plus grand défi de l’attention telle qu’elle peut se porter dans l’association libre : restaurer par le jeu et la pensée la possibilité d’une distance à soi, d’un espace analytique qui laisse entrevoir la réalité du désir au-delà de l’expérience du vide. Qu’est-ce que je veux vraiment quand je répète l’empêchement ? N’est-ce pas justement l’empêchement dont j’ai fait mon désir, pour ne jamais avoir ce que je veux, et dont il me faudrait alors faire quelque chose ?
L’ivresse des grands espaces
On peut entendre le vide comme une angoisse face à la réactivation d’un manque, d’une absence. Mais ne peut-on pas imaginer aussi un vide plein, qui viendrait percer précisément la nature illusoire de cette angoisse et des attachements qu’elle masque ? Dire d’une expérience, en méditation comme dans l’espace analytique, qu’elle a la nature du vide, ce n’est pas la nier ou la réduire, mais au contraire ouvrir la possibilité de notre liberté avec elle. Il m’est souvent proposé que le silence serait la principale conquête du travail analytique, mais que penser alors d’un silence rigide, non vide, qui serait pris comme prétexte des répétitions de nos névroses ? Un silence qui excuserait toute fixité dans une apparente déconstruction parce que c’est ainsi, parce qu’au fond il n’y aurait pas de penseur pour prendre la responsabilité de nos pensées ? Peut-être, pour reprendre les mots de Mark Epstein au sujet de l’espace méditatif qu’il s’agirait plutôt de revenir sur le sens vécu de ce « Je » qui parle et qui pense désirer, de « rediriger notre attention et notre agressivité de l’objet décevant vers le sujet mal perçu », de « permettre la pleine exploration des caprices [auxquels nous soumettent] nos émotions, tout en questionnant en permanence l’identification implicite que nous en faisons et qui parfois empêche toute profondeur d’investigation ». Pour ne pas se réduire finalement à n’être qu’un temps de cerveau humain disponible pour les Coca-Cola de notre existence, ne faut-il pas finalement se poser la question du sujet : à quoi est-ce que je veux me rendre disponible ? Ne s’agit-il pas de vivre la vacance comme un moyen plutôt que comme une fin ?
- Ecosystemix : une approche et des compétences écosystémiques des entreprises humaines, ouvrage collectif sous la direction d’Eva Matesanz, aux éditions de l’Harmattan.
- Pour détourner le titre de l’excellent ouvrage d’Anselme Grün, Ce que je veux je ne le fais pas, qui traite de la division intime dans laquelle nous nous plaçons quand notre quête radicale de l’unité ne fait plus place à nos antagonismes.
- In Composition médiatique d’un monde commun à partir du pluralisme des régimes d’attention / Conflit des interprétations dans la société de l’information. Chardel Pierre-Antoine; Gossart Cédric; Reber Bernard. Conflit des interprétations dans la société de l’information. Éthiques et politiques de l’environnement, Hermès Science, pp. 41-57, 2012.
- Adam Phillips, Stephen Greenblatt, Second Chances: Shakespeare and Freud, Yale University Press.
- Adam Phillips, Attention Seeking, éditions Penguin Books, 2019, p. 76.